LA QUETE DU GRAAL
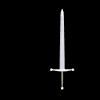
Dans les textes classiques, par exemple dans « Perceval » de Chrétien de Troyes, le Graal est souvent représenté par un simple récipient dont le contenu n’est pas décrit. Par la suite, il sera décrit comme un calice contenant le sang du Christ et comme l’écuelle qu’utilisa Jésus pendant la Cène. Dans « Parzival » de Wolfram Von Eschenbach, le Graal est une pierre tombée du ciel sur laquelle est déposée une hostie le vendredi de chaque semaine.
Selon la légende, c’est Perceval, pour les uns, Galaad, fils de Lancelot, pour les autres qui aurait trouvé le Graal. Pour certains, Perceval le Gallois est un héros païen qui trouve le Graal, plateau sur lequel repose une tête coupée dans le sang, et qui accomplit une vengeance rituelle par le sang. Pour d’autres, c’est un personnage au départ naïf qui finit par franchir les étapes de son initiation et devenir le Roi du Graal après avoir compris qu’il appartenait à la lignée royale. Le Perceval de la version cistercienne est secondaire derrière Galaad, un Lancelot sans défaut. Le Graal devient le symbole de l'Eucharistie.
Le lieu qui renfermerait le trésor mythique serait Montségur, appelé encore le Château du Graal. Ce dernier est mentionné dans un texte de Michel ANGEBERT. Dans l’évangile gnostique de Nicodème, le Graal chrétien est mentionné. Selon ce texte, Joseph d’Arimathie, un disciple du Christ, aurait recueilli, dans une coupe d’émeraude, le sang divin tombé des blessures du Sauveur causées par le coup de lance du centurion Longin, lors de la crucifixion.
Dans la grotte de Montréal-de-Sos (près de Capoulet dans l'Ariège), on a retrouvé une fresque, en partie détruite par l’humidité, remontant au moins au Xlllè siècle et représentant le vase mystique du Graal, entouré de croix latines et aussi une épée et un Soleil rayonnant.
